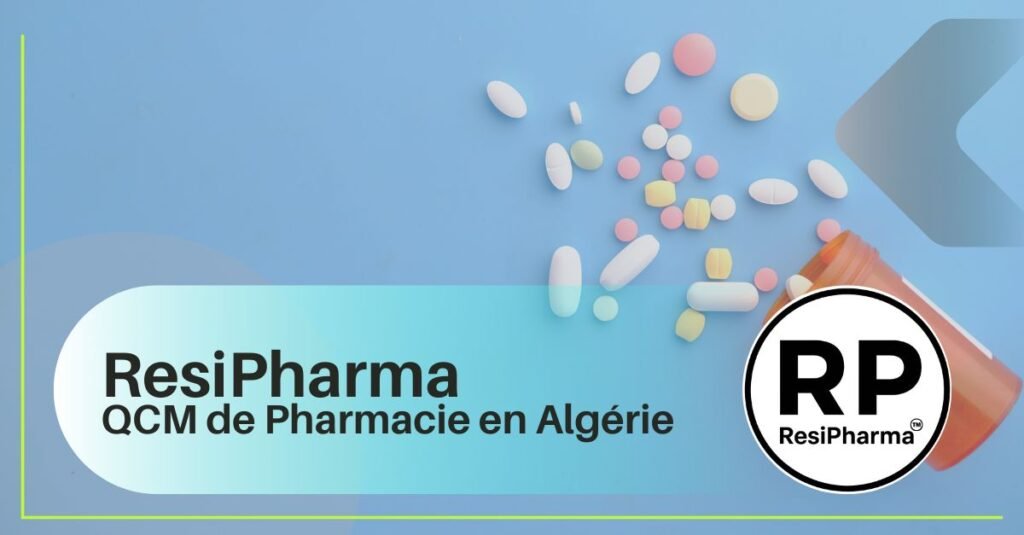LES GLUCIDES Etude structurale




d. Filiation des oses :



Filiation des 8 aldohexoses de la série D
Conséquences de la filiation des oses :
Série D ou L :
Chaque ose est rattaché à un triose initial (D ou L glyceraldehyde), selon la configuration spatiale de l’OH porté par le Cn‐1.
On distingue deux séries :
‐ Série D : le OH porté par le Cn‐1 est à droite ;
‐ Série L : le OH porté par le Cn‐1 est à gauche.
En tenant compte de ces deux séries, le nombre d’isomères possible est :
‐ 2n‐2 pour les aldoses
‐ 2n‐3 pour les cétoses
(n : nombre d’atomes de carbones)
Pouvoir rotatoire :
L’appartennance d’un ose à une série D ou L ne renseigne en rien de son activité optique :
‐ La série D ou L est déterminée par le OH porté par le Cn‐1
‐ l’activité optique est due à la somme des effets des différents carbones asymétriques, et elle est indiquée par le signe (+) ou (‐).
Un composé de la série D peut dévier la lumière à droite ou à gauche.
‐ Exemples :
Le D(+) glucose dévie la lumière à droite Le D(‐) fructose dévie la lumière à gauche.
Epimérisation :
Les épimères sont deux structures qui ne diffèrent entre elle que par un seul centre d’asymétrie dans une molécule qui en contient plusieurs.
‐ Exemples :
D‐ erythrose et D‐ thréose sont épimères en C2 D‐glucose et D –mannose sont épimères en C2 D‐glucose et D‐galactose sont épimères en C3
NB : l’épimérisation est possible par voie chimique ou enzymatique.
Diastéréoisoméres :
Les 08 aldohéxoses de la série D sont des diastéréoisoméres (non énantiomères).
Aucun n’est l »’image de l’autre dans un miroir.
Interconversion des oses :
Transformation ponctuelle d’un aldose en une cétose, l’équilibre s’établie entre une cétose et les deux aldoses épimères en C2.



Les aldoses et les cétoses correspondant au même nombre d’atomes de carbones sont dits isomères de structure (même formule brute avec des groupements fonctionnels différents).
2. Structure cyclique des oses :
La formule linéaire des oses est une représentation commode mais incomplète, elle ne permet pas d’expliquer un certain nombre de leur propriétés ;
Objections à la structure linéaire
Les oses ne recolorent pas la Fuchsine décolorée par le bisulfite(réactif de Schiff), alors que c’est une propriété générale des aldéhydes et cétones.
R‐CHO + NaHSO3 R‐ CHOH‐SO3Na
Formation d’Acétal
Les aldéhydes et les cétones sous forme hydratée, réagissent avec 2 molécules d’alcool pour donner des Acétals alors que les oses se combinent seulement avec 1 seule molécule d’alcool pour donner un Hémiacétal.

L’hémiacétal obtenu se présente sous 2 formes ayant un pouvoir rotatoire différent une forme α méthyl oside et une forme β méthyl oside ;
Exemple :
Glucose + méthanol deux methyl d‐glucosides :
α méthyl glucoside [α] D20°C = +159°
β méthyl glucoside [α] D20°C = ‐34° Par hydrolyse acide ; ces deux methyl d‐glucosides regenerent le D glucose , ceci prouve l’existance d’un centre d’asymetrie supplémentaire dans la molécule au niveau du groupement carbonyl ; la formule linéaire des oses ne permet pas d’expliquer ce phénomène.
Mutarotation (anomères) :
Lorsqu’on dissout un ose dans l’eau, le pouvoir rotatoire de la solution n’est pas instantanement fixe , il faut attendre un certain temps.LOWRY donna à ce phénomène le nom de « mutarotation ».
Ceci s’explique par l’existance de deux nouvelles formes isomères de l’ose qui aboutissent progressivement à un état d’équilibre, phènomene qui ne peut être expliqué dans le cadre de la structure linéaire.
Si l’on fait réagir le sulfate de méthyl SO4(CH3)2 sur un aldohexose (exp : le glucose) sous sa forme hydratée, la formule linéaire permet de prévoir l’obtention d’un dérivé héptaméthylé ; or, expérimentalement, on obtient un dérivé pentaméthylé.
D‐glucose
SO4(CH3)2
Dérivé héptaméthylé
Pour expliquer l’ensemble de ces anomalies réactionnelles, on propose une structure dans laquelle la fonction aldéhydique est partiellement bloquée sous forme de liaison hémi‐ acétalique avec l’une des fonctions alcool de l’ose.
Il s’établirait ainsi dans la molécule un pont oxydique, et un nouveau centre d’asymétrie apparait au niveau du C1.





Détermination de la position du pont oxydique :
Il existe plusieurs possibilités de formation d’un pont oxydique entre le groupement CHO et l’un des groupements alcool de la chaine.
Deux méthodes principales permettent de déterminer la position du pont oxydique :
‐ Méthode à l’acide périodique;
‐ Méthode de méthylation de HAWORTH.
Méthode à l’acide périodique (HIO4):
HIO4 possède la propriété de couper la chaine carbonée en provoquant la rupture de la liaison covalente entre deux atomes de carbones porteurs de fonction α‐ glycol.
Il apparait alors deux groupements carbonyliques :




Dans une chaine carbonée, lorsqu’il existe plusieurs fonctions alcool voisines, les fonctions alcools primaires donneront naissance à l’aldéhyde formique ( ‐CH2OH → H‐CHO) et les fonctions alcools secondaires donneront naissance à l’acide formique ( ‐CHOH → H‐COOH) .
Si un ose est traité par HIO4, l’emplacement du pont oxydique peut être déterminé par l’étude des produits formés et le nombre de molécules de HIO4 consommées, après avoir bloqué la seule fonction aldéhydique par méthylation.

Expérimentalement, le glucose traité dans les mêmes conditions donnent les résultats suivants :
‐ Consommation de 02 HIO4
‐ Obtention d’un HCOOH Pont oxydique C1 C5
‐ Pas de formation de HCHO
Méthylation de HAWORTH :

Triméthoxy‐xylarique

Représentation de la forme cyclique des oses : ( représentation de HAWORTH)